Apologues
La clef (extrait de Écrit en la secrète, 1992)
Il est un peuple (extrait de Légendaire, 2023)
Nouvelles
Marchand d'anges (extrait du Marchand d'anges, 2008)
Le siège © J.C. Bologne - publiée en ligne dans la revue Bon-à-Tirer
Extraits de romans
La Faute des femmes, 1989
L'ange des larmes, 2010
Emprises, 2023
Extraits d'essais
Une mystique sans Dieu, 2016
Extrait 1. "La clef", extrait de Écrit en la secrète, Les Éperonniers, 1992, © J.C. Bologne
Depuis l'aube des temps les pierres s'étaient ajoutées aux pierres pour élever d'immenses colonnes, droites et immuables, vers le ciel. C'étaient les prières de la terre, qui montaient vers Dieu, à l'infini, parallèles et solitaires, fières de leur quête absurde qui ne prendrait fin qu'au crépuscule des âges. Et sur chaque pierre carrée une autre pierre carrée, taillée au cordeau, s'engendrait sans autre but que de soutenir la suivante, dans l'attente éternellement différée du chapiteau trompettant une aléatoire résurrection. L'une ou l'autre tombait, sans doute, fragilisée par sa taille monstrueuse et déséquilibrée par un souffle de vent. Mais de se découvrir mortelles leur rendait plus précieuse encore la promesse du dieu que chantait leur sage poussée. Combien de siècles fallut-il pour qu'un moellon ose, discrètement, hausser une épaule ? Dans la chaîne irréfléchie de la colonne, la dissymétrie passa inaperçue; mais, reproduite de génération en génération, elle finit par infléchir la ligne droite. Une colonne se courba, chancela, tomba; puis une autre, et d'autres, par dizaines, centaines, fauchées sans s'en apercevoir par ce virus de révolte qui s'était infiltré dans leur progression régulière. Les colonnes intègres ricanaient de voir s'écrouler les rebelles et poursuivaient inlassablement leur course vers le ciel vide. Lorsqu'en se courbant jusqu'à la frontière du vertige, deux colonnes-révoltes s'approchèrent jusqu'à s'embrasser, un dieu tangible descendit entre leurs lèvres, un dieu de pierre pour elles seules qui vint sceller, dans l'éternité, un baiser à rendre jaloux les douairières dressées comme des cierges sans flamme. Dans l'arc bandé de leurs amours, Dieu s'était fait clef.


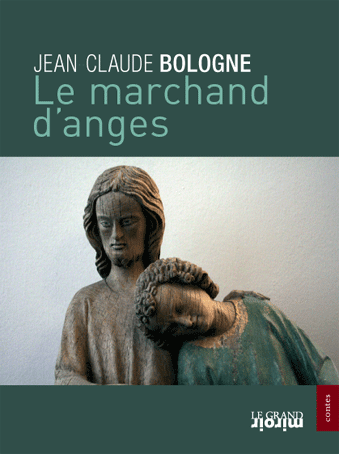
Extrait 2. Extrait de "Marchand d'anges", publié dans Marchand d'anges, 2008, © J.C. Bologne
Le marchand d’anges passe le dimanche. Nous l’attendons sans y penser, trop petits pour savoir ce qu’est l’attente, ni le désespoir. Il arrive du bout de la rue, jamais à la même heure, annoncé par sa trompette de marchand de glace — une note à peine plus grave. Il est à l’heure et nous sommes heureux, le temps d’un ange, comme nous le sommes le temps d’une glace. Nous avons l’âge où les rêves se conjuguent au présent.
Nos parents disent — c’est un pauvre homme — d’ailleurs il est pauvre et c’est un homme — mais cela ne suffit pas pour être un pauvre homme, peut-être faut-il vendre des anges ? Ils sourient, les adultes, gardiens du passé et du futur, quand ils parlent de lui. Peut-être, comme nous, ne connaît-il que le présent ? Il passe, la main levée, fermée, accrochée à son inconsistant bouquet de chérubins — marchand de ballons sans ballons, car les anges, pour les voir, il faut y croire, et dans notre rue, personne jamais ne les a vus. Les anges, pour nos yeux aveugles à trop fouiller la vie, ce n’est que l’appel d’une trompette au coin de l’avenue, et son cri "marchand d’anges, marchand d’anges", comme "chiffonnier", ou "marchand d’habits". Et puis son pas traînant, désabusé, que dément l’œil rieur, dextre tendue, ouverte, paume creusée pour recevoir la piécette, que dément le poing gauche dressé sur le bouquet imaginaire.
Les anges, pourtant, l’instant où il nous les fait voir, c’est son geste délicat, quand il a enseveli dans sa poche un sou bien réel pour cueillir dans son poing, comme un ballon gonflé d’hélium, une ficelle inexistante au bout de laquelle, on le devine ou on fait mine de le croire, gigote l’invisible prisonnier. Il nous la tend avec précaution — ne pas le lâcher, surtout, notre emplumé, il s’envolerait comme un ballon, vers le ciel, patrie des anges et des baudruches. "Qui n’a pas son ange ? Un ange pour un sou" — tous les dimanches au fond des poches, on trouve un sou pour l’ange, un sou pour le pauvre homme, il faut bien que tout le monde vive, n’est-ce pas ? et il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sots parents.
La mine grave, un ange en laisse entre pouce et index, nous revenons à la maison, le bras levé serrant une ficelle tressée de néant, et nous le sentons presque nous tirer vers le ciel, ce prisonnier de nos chimères. C’est lui qui alourdit notre bras, qui tétanise nos muscles, comme un chiot tirant sur sa laisse. Patience, mon ange, ton heure arrive... Car sur le seuil de la maison, nous le relâchons, bien sûr, comme un oiseau acheté à l’oiseleur pour le seul plaisir de lui rendre la liberté. Nous le suivons des yeux quand il regagne le ciel, chacun désigne le sien à son voisin — "Regarde mon ange, il vole plus vite, il vole plus haut — Menteur ! celui-là c’est le mien — Le tien, il perd ses plumes — Maman, empêche-le de tirer sur mon ange !" Les anges finissent toujours par regagner le ciel et la trompette, à l’angle du boulevard, s’éloigne déjà avec son bouquet de rêves. "Marchand d’anges, marchand d’anges..."
Extrait 3 (La Faute des femmes, Les Eperonniers, 1989, Prix Victor Rossel)
Contexte : délire d'une religieuse mystique du XIIIe s.
La montée était dure et nos pas enfonçaient dans la neige. Je ne sais si Vous étiez encore parmi nous, Seigneur, ou déjà planté au sommet comme un rameau enté sur le tronc mort du monde. Je vois seulement cette foule massée sur les pentes raides de la montagne. Longue procession gé-missante, partie heureuse pour assister au spectacle de Votre agonie et agonisante elle-même sur la croix des chemins enneigés. J'étais là parmi eux, plus lourde encore de ce linge où Vous aviez imprimé Votre Face. La sueur avait gelé sur la fine étoffe de lin, et Vos traits saillaient, minces couteaux de glace, éclats de verre transparents sur le voile blanc. Lourd, si lourd à porter quand les mains me trahissaient, quand les doigts engourdis ne pouvaient plus soutenir le moindre poids - ou était-ce Vous qui, comme sur le dos de Christophe, pesiez de toute Votre divinité pour me mettre à l'épreuve ? Mais je tenais, Seigneur, bras tendus, je Vous tenais, je n'étais plus que Vous parmi cette foule sans visage qui était Votre pas sur ce mont sans relief, lisse et blanc comme un crâne, qui était Votre mort.
Et moi j'étais Véronique, robe vide parmi les robes vides, néant perdu au sein des femmes de néant, mais tout entière justifiée par ce voile où restait empreint Votre amour. Et je pensais : qu'ai-je fait pour mériter de porter Votre Face ? Et je pensais : si Votre visage est si lourd entre mes mains, que sera-ce de Votre corps, de ce corps que je voulais sur moi, en moi, qui déjà était moi et avait consumé par sa seule présence les chairs mortes que j'entassais chaque matin dans ma robe de bure.
Mais il fallait Vous suivre et nos pas enfonçaient dans la neige et la neige mangeait nos pieds gelés et nous butions à chaque pas. Pitié Seigneur pour les robes pleurantes encordées au Golgotha.
Sous la neige parfois nous sentions la couche de glace. Et le coeur nous serrait de la savoir si proche, si mince, prête à se briser sous nos pas accumulés. Car sous la glace était le feu, le feu de la géhenne qui de toute éternité léchait la croûte interne de la terre. Que deviendrons-nous, mon Dieu, quand la flamme aura fait fondre la glace, quand la neige sous nos pas s'abîmera dans le brasier souterrain en grandes gerbes de vapeur ? Ah ! faites que nous soyons arrivés au sommet, à l'abri de Votre croix, quand ar-rivera le séisme !
Parfois, quand trop de pas se sont mis dans les précédents, la neige a disparu et une bulle d'air prise dans la glace devient une mince fenêtre, une vitre fragile ouverte sur l'enfer. Et l'on voit les ombres rouges danser à travers ce hublot et le sang se glace dans nos veines. Que font, que font ces moines de part et d'autres de la route ? Arrêtez ! Arrêtez ! Vous ne voyez pas que vous aller briser la glace ? Mais ils continuent, imperturbables, acharnés, avec la force de la dernière heure, à marteler le sol à grands coups de hache. Quand la glace enfin est rompue sous leurs pieds, ils s'effondrent dans un jet de va-peur jailli comme un souffle furieux des na-seaux de l'enfer. Et l'on ne sait si le rire dément qui accompagne leur chute est le leur ou celui de diables qui s'emparent de leur âme. À chaque moine tombé dans la montagne, le sol chancelle et tremble sous nos pas et déjà nous voyons l'instant où le monde entier s'anéantira dans le feu. Mais faites-leur comprendre qu'ils ne se pu-rifient pas en détruisant le monde ! J'ai peur, Seigneur, nous avons tous peur parce que nous sentons notre der-nière heure trop proche et qu'il n'y aura pas place pour tout le monde sous les bras de Votre croix.
Déjà j'aperçois le sommet à travers les nuages - loin, si loin, Seigneur, arriverai-je jamais là-haut, laisserez-Vous assez de force dans ces jambes que je ne sens plus, dans ce corps que Vous avez déjà vidé de sa subs- tance ? Je tends les bras, je tends Votre visage à bout de bras comme un drapeau de paix pour que Vous me reconnaissiez dans la foule qui Vous suit. Mais elle grossit à chaque instant et chacun tend un clou, un glaive, une palme, un signe de reconnaissance que je ne comprends pas mais qui doit Vous parler comme ce linge blanc où brûle un visage transparent. Ayez pitié de Véronique, Seigneur, rappelez-Vous qu'en passant Vous lui avez fait un signe, un signe d'amour, je Vous le jure, Seigneur, rien qu'une se-conde, oh, un si court instant sans Vous arrêter dans Votre marche, mais ne savez-Vous pas glisser l'éternité en un instant ? La preuve, c'est qu'il m'a suffi pour que je me mette en marche, avec Vous, après Vous, que je re-joigne ce flot humain qui devient une autre montagne sur le volcan de glace, une montagne de chair prête à porter Votre croix quand aura fondu le fragile socle de Votre Gloire. Une montagne de chair damnée pour que Vous puissiez vivre dans les siècles de siècles, chair qui déjà n'est plus chair mais cendre, amour, néant, que sommes-nous depuis que nous Vous avons croisé ? Ayez pitié, Seigneur, que je ne sois pas confondue parmi ces femmes à qui Vous avez donné un instant de Votre amour. Déjà je vois à Vos côtés ces robes vides dont Vous avez sucé le corps de Votre mère, le corps des saintes femmes qui Vous avaient suivi. Est-ce là Votre amour ? Dites-moi non avant que je ne me damne, dites-moi que je ne plonge pas pour rien dans la géhenne qui fait craqueler la glace. Si mince l'enveloppe de la terre, si mince, la frontière entre le feu et le salut, encore un peu de force, quelques minutes de répit et je suis sauvée, Seigneur. Mais mes pas... si lourds... la neige... long baiser tentateur à mes pieds engourdis... Tendez-moi la main, mon Dieu.
Que faites-Vous ? Quelle folie Vous prend comme ces moines ? Jetez cette croix, n'essayez pas de la planter dans le mince support de la glace ! Vous savez qu'elle ne résistera pas. Voulez-Vous faire exploser le mont, faire exploser le monde ? Pitié pour nous, pour toutes ces ombres aggluti-nées à leur espoir. Non, Seigneur, NON !
Le monde a éclaté comme une bulle. Noire est la nuit, étroite ma cel-lule. Et je ne sais plus si je suis le rêve de soeur L*** ou la mort de Véronique.
Extrait 3, L'ange des larmes, Calmann Lévy, 2010
Contexte : l'ange qui hante le narrateur tente de le rassurer
" N’aie pas peur : tu ne me verras pas, tu ne m’entendras pas. Je resterai assis, près de la fenêtre. S’il ne fait pas trop froid, laisse-la entrouverte. Je ne peux me risquer entre quatre murs. J’ai besoin d’un pan de ciel à portée de mémoire, comme un malade garde ses gouttes sous la main. Et depuis ma chute, je suis muet. Tu ne m’entendras pas, tu ne me verras pas, mais tu me sauras là, près de toi. C’est ta douleur qui m’a suscité, ce creux de l’âme où naissent les archanges. Je la connais bien. Je connais toutes les douleurs, je sais le goût de chaque larme, celles du deuil, celles de la rage impuissante, du gros chagrin qu’on mouche, du calme désespoir. Les tiennes ne couleront pas : tu es trop fier. Mais elles ont eu la force de me convoquer dans ta chambre.
Je sais : tu n’as pas besoin d’aide. Cela tombe bien. Que pourrais-je faire pour toi ? Je n’ai pas de pouvoir, pas de relation, pas même de charme, ni l’argent qui te manque. Je n’ai que ma présence, et tu ne la sauras pas. Tu pourras grâce à moi te croire seul et parler à quelqu’un, ou te croire un ami en restant solitaire. Je me plierai à tes humeurs. Aie confiance. N’aie pas peur.
Mon nom est Cassiel, l’archange blessé, l’archange des larmes. Un jour, peut-être, tu comprendras pourquoi j’ai perdu le pouvoir de m’adresser aux hommes. J’ai reçu en échange le redoutable don d’entendre ce qui ne passe plus par les mots. Qui pourrait imaginer le tumulte de tous ces silences ? Les mots usent avec la patience d’un fleuve les arêtes de la douleur : plus il grossit, plus on navigue en paix sur cette confortable certitude. Quand il tarit, on s’écorche les pieds sur le lit mis à sec. Je suis l’ange des torrents asséchés, des gaves de haut été, des ouadi rongés par les déserts de pierre. Je ne calmerai pas ta douleur : je la porterai jusqu’à l’insoutenable, là où elle devient belle, je l’aviverai jusqu’à l’incandescence. Aie confiance.
N’aie pas peur. Il te sera toujours loisible, si tu le souhaites, de te réfugier dans l’ombre de ta chambre, dans la moiteur d’un lit, dans l’encoignure d’un cafard bougon. Je ne te suivrai pas dans les marigots de la douleur. Un jour, peut-être, tu apprendras pourquoi je ne m’éloigne jamais de la fenêtre. Le plus tard possible, j’espère. J’ai pris les hommes en affection, et je n’ai plus goût à la fin du monde. Je suis l’ange des désespoirs arides, des consternations majeures, qui burinent des profils d’aigle et des statues de sel. Je fuis l’enlisement des prostrations, la poussière des résignations vaincues. Ouvre la fenêtre, pour le seul désir de la franchir : je serai là, à tes côtés. Je m’appelle Cassiel, et nous nous aimerons."

Père Lachaise, © J.C. Bologne

Extrait 5, Autel au dieu inconnu, extrait d'Une mystique sans Dieu, Albin Michel, 2015
Il n’y aura pas, il ne peut y avoir de conclusion. Mais si j’ai ouvert ce livre sur une pierre, la pierre d’achoppement qui met en course, je l’achèverai sur une autre, l’autel, la pierre brute sur laquelle a reposé la tête de Jacob, pour une autre mise en course. Mon autel décidément n’a pas de Dieu. S’il peut, comme les anciens, laisser la place à un dieu inconnu , c’est un dieu encore à naître. Peut-être est-ce l’ultime défi de l’athée : de créer Dieu par la littérature. « Comment brûler sa vie sans renoncer à soi et sans inventer Dieu ? », demande Jean-Louis Poitevin. Ce Dieu qu’il me reste à créer, non comme une idole, mais comme une nécessité, je suis prêt à y croire, ou du moins à lui laisser sa chance. Oui, il ne peut naître que de sa nécessité, comme le vide appelle l’infini, comme l’âme détachée, chez maître Eckhart, « oblige » Dieu à entrer en elle, car si l’infini résiste à l’appel du néant, c’est qu’il n’est pas l'infini, et si la pluie ne pénètre pas dans le vase, c’est qu’il ne pleut pas. Peut-être est-ce le paradoxe le plus singulier, et le rôle de l’athée, d’obliger Dieu à naître. « Le Dieu absent est un appel plus fort que la croyance », dit un personnage de Frédérick Tristan. C’est celui-là qui m’a appelé, parce qu’il serait nécessaire qu’il soit.
Cet ange qui se crée, pour rabbi Pinhas, lorsque deux hommes se rencontrent véritablement, nous l’avons tous connu dans le véritable amour, celui qui ne se résume pas à l’addition de deux entités, mais qui en fonde une troisième. Dans les rencontres qui ont suivi certaines des conférences que je donnais sur ce sujet, il m’a parfois semblé percevoir un clin d’œil de cet ange. La vie d’un ange est de douze mois, dans le comte hassidique, la vie des miens n’a pas dépassé quelques secondes. Mais si ces rencontres se multipliaient, si sept milliards d’individus reproduisaient en permanence cette étincelle éphémère, je serais prêt à donner à cette communion générale le nom de Dieu. À une époque où les tensions religieuses s’exacerbent en fondamentalismes plus attachés aux concepts qu’à l’expérience, le mysticisme peut offrir un espoir d’apaisement en fondant le partage sur l’expérience de chacun. Ainsi, pour paraphraser René Char, pourrons-nous naître avec les hommes et mourir parmi les dieux.

Extrait 6. Emprises, les contes du père Susar, maelstrÖm, 2023.
Contexte : le père Susar évoque le vieux conte qui explique les dons que chacun reçoit.
Il y a toujours eu un peu d’or dans ma famille. Les uns l’ont dans les mains, les autres dans la tête, mon petit-fils Jacques l’a dans la voix et mon père l’avait dans les mots. C’est de lui que je tiens mes récits et mon don de révéler aux hommes le nom qui guide leur destin. Mais c’est de l’or ensorcelé. On dit qu’il fut apporté par la corneille de Sainte-Marguerite, vous savez, celle qui niche dans le clocher et qui, le jour de Pâques, vient pondre un œuf d’or dans un des greniers de la paroisse. Ce jour-là, vous ne trouverez pas une fenêtre close. Chacun espère que la corneille viendra pondre chez lui. Mais celui qui a trouvé l’œuf au matin ne le dira à personne.
Car l’œuf de la corneille n’apporte pas le bonheur. Il assure à la famille qui le trouve des talents sans précédents, mais l’étrange impossibilité d’en tirer le moindre profit. De mes mains d’or, j’ai sculpté les plus beaux meubles de la ville et les plus beaux saints des églises, mais j’ai toujours été pauvre. Avec sa voix d’or, Jacquot n’a pu qu’endetter son père auprès de la maîtrise de Saint-Denis. Les contes de mon père n’ont pu que faire rire les enfants et la beauté de ma fille n’a séduit qu’un châtré et un couillon. C’est ainsi et nous n’y pouvons rien. Si je retrouvais la corneille de Sainte-Marguerite, je lui renfoncerais son œuf dans le cul, mais voilà, comme elle n’existe pas et l’œuf non plus, j’ai peu de chance d’y parvenir.
Alors, à quoi bon l’œuf de corneille, me direz-vous ? C’est là tout le secret des légendes. Il n’a pas été pondu sous les combles de nos maisons, mais dans notre âme, qui est le grenier du corps. Et c’est là qu’il éclot. C’est de là qu’il irradie, dans tout le corps, durant toute la vie. Oui, nous avons tous, de père en fils et de mère en fille, une incroyable aptitude au bonheur. Avec trois patårds dans notre poche, nous mettons du soleil dans les nuages, de l’arc-en-ciel dans la pluie, nous changeons l’eau en vin et le bois en dentelle. Le bois sec bourgeonne, les mots bouillonnent et parfois l’Esprit souffle par notre bouche. Mais nous ne transformerons jamais les trois patårds en patacons. Voilà, c’est comme cela et c’est bien comme cela. Les sourires sur les lèvres et les étoiles dans les yeux des enfants nous disent que c’est bien comme cela.

Extrait 7. Légendaire, Le Taillis Pré, 2023.
Il est un peuple habile à découper et à recoudre le temps. Pour ne pas vivre les périodes de deuil, de chagrin ou de misère, il déchire d’un coup sec le tissu de jours et de secondes, qu’il rafistole vaille que vaille avec la suite de son cours. On a vu ainsi des mères arrêter le temps à la mort d’un enfant et reparaître une fois le deuil achevé. C’est une faculté qui apparaît et se développe avec l’âge, quoiqu’on ait vu des enfants précoces échapper ainsi à un examen ou à une fessée. Il faut une certaine maturité pour en user avec parcimonie. Car si le temps disparaît, le vieillissement perdure. Depuis qu’on a vu un adolescent emprisonné pour meurtre se réveiller le lendemain libre dans un corps cinquantenaire, on se méfie de ce don hasardeux. On l’utilise le week-end pour échapper à un confinement, ou lors d’une opération si l’on ne peut supporter l’anesthésie, mais il a été interdit d’en exiger l’usage d’un patient réticent. Car il peut y avoir de mauvaises surprises et lorsque le pan temporel est coupé, il ne peut être recousu tel quel. Un téméraire, un jour, n’a pas retrouvé la pièce à raccorder à sa vie. Sa mort était survenue dans le laps de temps qu’il avait sectionné.
